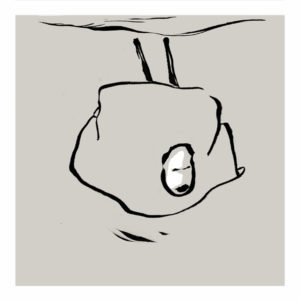 1.
1.
MA LANGUE BIEN PENDUE – EST CELLE DU PEUPLE. Tellement que je parle de manière trop grossière et trop cordiale pour les gens de bien, les lapins sans cœur mais au pelage de soie. Et mon langage résonne de façon encore plus étrangère aux oreilles des plumitifs, des poissons qui barbotent dans l’encre et autres gratte-papiers dont la plume est aussi rusée qu’un renard.
Ma main – est une main de bouffon. Elle ne peut se retenir de dessiner : malheur à toutes les tables, toutes les parois et tout ce qui a encore de la place pour des ornements et des gribouillages de bouffon !
Mon pied – est un pied fourchu. Grâce à lui je trotte et galope par monts et par vaux, en long et en large, le diable au corps, rempli de joie chaque fois que je cours vite.
Mon estomac – n’est-il pas un estomac d’aigle ? Car de tous les aliments, c’est la viande d’agneau qu’il préfère. Une chose est sûre : il s’agit d’un estomac d’oiseau.
Je suis désormais du genre à me nourrir de choses innocentes, de peu de choses innocentes, toujours prêt à voler, toujours impatient de voler, de m’envoler au loin. Comment se pourrait-il qu’il n’y ait pas là quelque chose du genre de l’oiseau !
Et ce qui est d’autant plus du genre de l’oiseau, c’est que je suis l’ennemi de l’esprit de lourdeur. Passionnément : j’en suis l’ennemi mortel, l’ennemi juré, l’ennemi originel ! Où donc ma haine n’a-t-elle pas déjà volé et ne s’est-elle pas déjà perdue en volant pour me battre contre l’esprit de lourdeur, en moi et autour de moi ?!
Je pourrais bien chanter une chanson là-dessus – – d’ailleurs je veux et vais le faire ! Même si je suis seul, dans une maison vide, même si je dois la chanter à mes propres oreilles.
Il existe bien sûr des chanteurs différents de moi ; des chanteurs qui doivent se trouver dans une maison pleine pour que leur gosier devienne doux, leur main loquace, leur œil expressif, leur cœur éveillé… Mais le solitaire que je suis ne leur ressemble en rien.
2.
Celui qui, un jour, apprendra aux hommes à voler aura au préalable déplacé toutes les bornes, révolutionné leur manière de penser ; leur vision du monde elle-même volera dans les airs. Et la terre, il la baptisera d’un nouveau nom : loin d’être la lourde, la pesante, elle s’appellera désormais « la légère ».
Bien sûr, l’autruche a pour qualité de courir plus vite que le cheval le plus rapide, mais elle a en même temps pour défaut de cacher lourdement sa tête dans la lourde terre en cas de danger. L’homme qui ne sait pas encore voler fait pareil : espérant s’envoler, il avance à toute vitesse, il cherche à tout prix à progresser ; mais les problèmes, il refuse de les regarder en face.
La terre et la vie lui semblent deux choses désagréables, lourdes à porter. Ce n’est pas lui qui choisit : c’est l’esprit de lourdeur qu’on lui a enfoncé dans la tête qui veut qu’il en soit ainsi ! Mais celui qui veut devenir léger, qui veut devenir un oiseau, doit commencer par s’aimer soi-même en ce qu’il est, partie intégrante de la terre et de la vie : voilà ce que j’enseigne, moi !
S’aimer soi-même : bien sûr non pas d’un amour traditionnel, tel celui des malades et des dépendants. Car chez eux l’amour-propre lui-même sent mauvais, tant il repose sur des histoires idéalistes qu’ils se racontent, souvent en comparaison d’avec autrui !
Ce que j’apprends, moi, c’est à s’aimer soi-même d’un amour sain et bien portant, qui regarde les choses en face, et de biais aussi : pour qu’on supporte d’être chez soi, seul avec soi-même, sans se cacher ; pour qu’on ne vagabonde pas, ne s’adonne pas à la fuite en avant, à des rapports superficiels avec des gens superficiels, au bavardage, au divertissement, aux suppléments d’âme.
Un tel vagabondage, c’est ce qu’on appelle « amour du prochain » : c’est avec ce mot – véritable guide-âne – qu’on a jusqu’à ce jour le mieux menti, qu’on a été le plus hypocrite ; et les champions en la matière, ce sont justement les gens lourds, les gens pesants pour le monde entier.
En vérité, apprendre à s’aimer soi-même, ce n’est pas un commandement pour aujourd’hui et pour demain. Bien plus : de tous les arts, c’est le plus fin, le plus rusé, le dernier et le plus patient. Un art de tous les instants.
Car le plus propre, le plus authentique est caché à l’homme authentique ; et de tous les trésors, le dernier qu’on découvre est toujours celui qui nous appartient le plus en propre – voilà le fruit du travail de l’esprit de lourdeur ; voilà ce qu’il nous fait croire.
Presque dans le berceau déjà, on nous donne des mots et des valeurs d’une immense lourdeur : « bien » et « mal » – voilà comment s’appelle la dot pour la vie. Elle est la justification de l’existence ; c’est grâce à elle, parce qu’on nous éduque à elle que les gens tolèrent qu’on vive.
Et tout le monde fait de même avec les petits enfants : on les laisse venir à soi pour leur inculquer les lourdes valeurs du « bien » et du « mal », les empêchant par là à temps de s’aimer soi-même : voilà le fruit du travail de l’esprit de lourdeur.
Et nous – nous traînons fidèlement, sans broncher, ce qu’on nous donne à porter sur nos dures épaules et sur les arides montagnes ! Et si on transpire, si on montre des difficultés, de la souffrance, on nous dit : « Oui, la vie est lourde à porter ! »
Mais l’homme est le seul phénomène du monde à pouvoir se trouver lui-même lourd à porter ! Cela vient du fait qu’il porte trop de choses qui ne lui appartiennent pas sur ses épaules, qu’on lui inculque trop de choses qui lui sont étrangères. Tel le chameau, l’homme s’agenouille et se laisse volontiers charger.
Surtout l’homme fort, l’homme habité par le respect, le porteur-né : il se charge de tous les mots et de toutes les valeurs pesants et étrangers – pour finir par considérer la vie comme un désert !
En vérité ! Il y a en nous, en notre être propre, bien des choses lourdes à porter ! Bien des choses à l’intérieur de l’homme sont comme les huîtres, c’est-à-dire répugnantes, visqueuses et difficiles à saisir –
– de sorte qu’une noble coquille avec un noble ornement doive intercéder pour elles. Mais l’art d’avoir une coquille pour se protéger, une belle apparence pour faire bonne figure et un aveuglement avisé pour bien avancer sur son chemin, il ne tombe lui non plus pas du ciel, on doit lui aussi l’apprendre !
Une fois encore, il y a beaucoup de choses trompeuses en l’homme : certaines coquilles sont par exemple faibles et tristes, et par-dessus tout trop coquilles. Jamais, en-dessous, on ne devine beaucoup de bonté et de force cachée ; les plus exquises friandises ne trouvent pas d’amateur !
Les femmes le savent, elles, les plus exquises : un peu plus grasses, un peu plus maigres – oh, tant de destin repose sur si peu de choses !
L’homme est difficile à découvrir et c’est encore à soi-même qu’il l’est le plus ; souvent l’esprit, l’intelligence rationnelle, ment par-dessus l’âme, le souffle animant. Voilà le fruit du travail de l’esprit de lourdeur.
Mais celui qui se dit « ceci est mon bien et mon mal » s’est découvert lui-même : il est parvenu à faire taire le nain et la taupe que je déteste et qui proclament un « bien pour tous, mal pour tous », des valeurs universelles.
En vérité, je n’aime pas non plus ceux qui appellent toutes choses bonnes et vont même jusqu’à dire que ce monde, tel qu’il est, est le meilleur, le meilleur des mondes possibles. Ceux-là, je les appelle les peu-exigeants-de-tout.
La faible-exigence-de-tout qui sait goûter de tout, ce n’est pas le meilleur goût ; ce n’est pas le palais le plus fin ! Loin de ceux-là, j’honore les langues et les estomacs récalcitrants et difficiles, qui non seulement ont appris à dire « Moi », mais aussi à dire « Oui » et « Non ».
Tout mâcher et tout digérer – c’est là une vraie conduite de porc ! Toujours dire oui-da (« I-A ») – seul l’âne l’a appris et quiconque a comme lui un esprit d’âne.
Ce que veut mon goût, c’est du jaune profond et du rouge chaud. Il mélange du sang à toutes les couleurs. Mais quiconque peint sa maison tout en blanc me révèle une âme toute blanche, sans couleur, sans vie.
Les uns sont amoureux de momies, les autres de fantômes ; et tous deux sont les ennemis de toute viande et de tout sang – oh, comme ils vont tous deux à l’encontre de mon goût ! Car moi, j’aime la chair, j’aime le sang.
Et je ne veux pas habiter et demeurer là où tout le monde crache sur ce qui ne lui plaît pas et bave devant ce qui lui plaît : tel est désormais mon goût. Je préférerais encore vivre parmi les voleurs et les parjures que parmi eux, les critiques. Car nul d’entre eux n’a de l’or dans la bouche.
Mais les lèche-bottes me dégoûtent plus encore. Et parmi tous les animaux que j’ai pu trouver dans l’homme, le plus répugnant, je l’ai baptisé parasite, pique-assiette : celui qui, bien qu’il ne veuille pas aimer, ne veuille pas faire les efforts qu’exige l’amour, veut pourtant vivre d’amour.
J’appelle malheureux tous ceux qui n’ont qu’un choix, soit de devenir de méchants animaux, soit de méchants dompteurs. Auprès d’eux, je ne me bâtirais jamais de cabane.
J’appelle aussi malheureux ceux qui doivent toujours attendre : tous ces douaniers, ces épiciers, ces rois et autres gardiens d’états et de boutiques toujours projeté vers l’avenir vont eux aussi à l’encontre de mon goût.
En vérité, j’ai moi aussi appris à attendre, et ce dès le début, du plus profond de moi-même. Mais contrairement à la plupart, je n’ai pas appris à attendre quelque chose, mais seulement à m’attendre moi, à me découvrir moi. Et j’ai par-dessus tout appris à me tenir debout, dans toute situation, et à marcher, et à courir, et à sauter, et à grimper, et à danser.
Tel est mon enseignement : quiconque veut un jour apprendre à voler doit d’abord apprendre à se tenir debout, et à marcher, et à courir, et à grimper, et à danser. Car le vol n’est pas quelque chose qu’on attrape comme ça, au vol !
J’ai appris à escalader toutes sortes de fenêtres avec des échelles faites de cordes ; les jambes prestes, le pied agile, j’ai grimpé au sommet de hauts mâts. Je ne m’en cache pas : être assis sur de hauts mâts de la connaissance ne m’est jamais apparu comme un faible bonheur.
Ah, vaciller pareil à de petites flammes sur de hauts mâts : être une petite lumière, certes, mais un grand réconfort pour les marins perdus et les naufragés !
Je suis arrivé à ma vérité par toutes sortes de chemins et de manières : je n’ai pas grimpé sur une seule échelle vers la hauteur où mon œil vagabonde dans mon lointain.
Et c’est toujours à contrecœur que je demandais mon chemin : demander mon chemin, cela aussi a toujours été à l’encontre de mon goût ! Je préférais encore interroger et essayer moi-même les chemins.
Tout mon cheminement a été une tentative et une interrogation. Et en vérité, il faut aussi apprendre à répondre à une telle interrogation ! Mais tel est mon goût :
Pas un bon goût ou un mauvais goût, mais simplement mon goût, mon goût à moi, dont je n’ai ni à avoir honte ni à faire un mystère.
« Tel est désormais mon chemin, mon chemin à moi – où est le vôtre ? », voilà comment je répondais à ceux qui me demandaient « le chemin ». Car le chemin – n’existe pas !
Parole de Zarathoustra.
***
Traduction littérale
1.
Ma langue bien pendue – est celle du peuple : je parle de manière trop grossière et trop cordiale pour les lapins de soie. Et mon langage résonne de façon encore plus étrangère à tous les poissons d’encrier et renards de plume.
Ma main – est une main d’un bouffon : malheur à toutes les tables et toutes les parois, et tout ce qui a encore de la place pour des ornements de bouffon et des gribouillages de bouffon !
Mon pied – est un pied fourchu ; grâce à lui je trotte et galope par monts et par vaux, en long et en large, et ai le diable au corps de joie chaque fois que je cours vite.
Mon estomac – est bien un estomac d’aigle ? Car ce qu’il préfère est la viande d’agneau. Mais il est en tout cas un estomac d’oiseau.
Nourri de choses innocentes et de peu, prêt à et impatient de voler, de s’envoler de là – tel est mon genre : comment quelque chose de cela ne serait-il pas du genre de l’oiseau !
Et ce qui est d’autant plus du genre de l’oiseau, c’est que je suis l’ennemi de l’esprit de lourdeur : et vraiment, ennemi mortel, ennemi juré, ennemi originel ! Oh, où n’a pas encore volé et ne s’est pas encore perdue en volant ma haine !
Je pourrais déjà chanter une chanson là-dessus – – et veut la chanter : bien que je sois seul dans une maison vide et que je doive la chanter à mes propres oreilles.
Il existe bien sûr d’autres chanteurs, dont seule la maison pleine rend leur gosier doux, leur main loquace, leur œil expressif, leur cœur éveillé : – je ne ressemble pas à ceux-là. –
2.
Celui qui un jour apprendra aux hommes à voler aura déplacé toutes les bornes ; les bornes elles-mêmes vont voler pour lui dans les airs, il baptisera à nouveau la terre – comme « la légère ».
L’autruche court plus vite que le cheval le plus rapide, mais même elle cache encore lourdement la tête dans la lourde terre : ainsi l’homme qui ne sait pas encore voler.
Lourdes lui semblent la terre et la vie ; et voilà ce que veut l’esprit de lourdeur ! Mais celui qui veut devenir léger et un oiseau doit s’aimer soi-même : – voilà ce que j’enseigne, moi.
Non pas bien sûr de l’amour des malades et des dépendants : car chez eux l’amour-propre lui-même sent mauvais !
On doit apprendre à s’aimer soi-même – voilà ce que j’enseigne – d’un amour sain et bien portant : pour qu’on supporte d’être chez soi et ne vagabonde pas.
Un tel vagabondage s’appelle « amour du prochain » : avec ce mot on a jusqu’alors le mieux menti et été hypocrite, et en particulier ceux qui étaient lourds pour le monde entier.
Et en vérité, apprendre à s’aimer, ce n’est pas un commandement pour aujourd’hui et demain. Bien plus, de tous les arts, c’est le plus fin, le plus rusé, le dernier et le plus patient.
Car ce qui lui est propre est caché à celui qui est en propre ; et de tous les trésors, le dernier qu’on découvre est celui qui vous appartient – voilà ce que fait l’esprit de lourdeur.
Déjà presque dans le berceau on nous donne des mots et des valeurs lourds : « bien » et « mal » – voilà comment s’appelle cette dot. Pour celle-ci, les gens tolèrent qu’on vive.
Et pour ce faire, on laisse venir à soi les petits enfants, pour qu’on les empêche à temps de s’aimer soi-même : voilà ce que fait l’esprit de lourdeur.
Et nous – nous traînons fidèlement ce qu’on nous donne à porter sur des épaules dures et des montagnes arides ! Et si on transpire, on nous dit : « Oui, la vie est lourde à porter ! »
Mais seul l’homme est lourd à porter pour lui-même ! Cela vient du fait qu’il traîne trop de choses étrangères sur ses épaules. Tel le chameau, il s’agenouille et se laisse bien charger.
Surtout l’homme fort, porteur, habité par le respect : il se charge de trop de mots et valeurs lourds et étrangers – et il voit alors la vie comme un désert !
En en vérité ! Il y a aussi beaucoup de choses qu’on a en propre qui sont lourdes à porter ! Et beaucoup de choses à l’intérieur de l’homme sont comme l’huître, c’est-à-dire répugnante et visqueuse et difficile à saisir –,
– de sorte qu’une noble coquille avec un noblement ornement doit intercéder pour elles. Mais cet art aussi, on doit l’apprendre : avoir une coquille et une belle apparence et un aveuglement avisé !
Une nouvelle fois de nombreuses choses sont trompeuses en l’homme, que certaines coquilles sont faibles et tristes et trop coquilles. Beaucoup de bonté et de force cachées ne sont jamais devinées ; les plus exquises friandises ne trouvent pas d’amateur !
Les femmes le savent, les plus exquises : un peu plus grasses, un peu plus maigres – oh, il y a tant de destin qui tient à si peu de choses !
L’homme est difficile à découvrir et à soi-même encore le plus dur ; souvent l’esprit ment sur l’âme. Voilà ce que fait l’esprit de lourdeur.
Mais il s’est découvert lui-même celui qui dit ceci : ceci est mon bien et mal : il a par là rendu muet le nain et la taupe qui disent : « Bien pour tous, mal pour tous. »
En vérité, je n’aime pas non plus ceux qui appellent toutes choses bonnes et ce monde même le meilleur. Ceux-là, je les appelle les peu-exigeants-de-tout.
La faible exigence de tout qui sait goûter de tout : ce n’est pas le meilleur goût ! J’honore les langues et les estomacs récalcitrants et difficiles, qui ont appris à dire « Moi » et « Oui » et « Non ».
Mais tout mâcher et tout digérer – c’est là une vraie conduite de porc ! Toujours dire oui-da (I-A) – seul l’âne l’a appris et quiconque a le même esprit.
Le jaune profond et le rouge chaud : c’est là ce que veut mon goût, – il mélange du sang à toutes les couleurs. Mais qui badigeonne sa maison en blanc me révèle une âme badigeonnée de blanc.
Les uns amoureux de momies, les autres de fantômes ; et tous deux ennemis de toute viande et de tout sang – oh, comme tous deux vont à l’encontre de mon goût ! Car j’aime le sang.
Et je ne veux pas habiter et rester là où chacun crache et bave : tel est désormais mon goût – et je préférerais encore vivre parmi les voleurs et les parjures. Personne ne porte d’or dans la bouche.
Mais les lécheurs me dégoûtent plus encore ; et l’animal le plus répugnant que j’ai trouvé dans l’homme, je l’ai baptisé parasite : il ne voulait pas aimer et pourtant vivre d’amour.
J’appelle infortunés tous ceux qui n’ont qu’un choix : devenir de méchants animaux ou de méchants dompteurs : auprès d’eux je ne me bâtirais pas de cabane.
J’appelle aussi infortunés ceux qui doivent toujours attendre, – ils vont à l’encontre de mon goût : tous ces douaniers, épiciers et rois et autres gardiens d’états et de boutiques.
En vérité, j’ai moi aussi appris à attendre, et à partir du fond, – mais seulement à m’attendre moi. Et j’ai par-dessus tout appris à être debout et à marcher et à courir et à sauter et à grimper et à danser.
Mais tel est mon enseignement : quiconque veut un jour apprendre à voler doit d’abord apprendre à être debout et à marcher et à courir et à grimper et à danser : – on n’attrape pas le vol au vol !
J’ai appris à escalader toutes sortes de fenêtres avec des échelles de cordes, les jambes prestes j’ai grimpé au sommet de hauts mâts : être assis sur de hauts mâts de la connaissance ne m’apparaissait pas comme un faible bonheur, –
– vaciller pareil à de petites flammes sur de hauts mâts : certes une petite lumière, mais un grand réconfort pour les marins perdus et les naufragés ! –
Je suis arrivé à ma vérité par toutes sortes de chemins et de manières : je n’ai pas grimpé sur Une échelle vers la hauteur où mon œil vagabonde dans mon lointain.
Et c’est toujours à contrecœur que je demandais mon chemin, – ça a toujours été à l’encontre de mon goût ! Je préférais demander et essayer moi-même les chemins.
Tout mon cheminement a été une tentative et un questionnement : –et en vérité, il faut aussi apprendre à répondre à un tel questionnement ! Mais tel – est mon goût :
– pas un bon, pas un mauvais, mais mon goût, dont je n’ai ni à avoir honte ni à faire un mystère.
« Tel – est désormais mon chemin, – où est le vôtre ? » voilà comment je répondais à ceux qui me demandaient « le chemin ». Car le chemin – cela n’existe pas !
Parole de Zarathoustra.
***
Il s’agit là du onzième chapitre de la « Troisième partie » des « Discours de Zarathoustra » du Zarathoustra de Nietzsche. Texte phusiquement réinvesti (en haut) et traduction littérale (en bas). Les précédents chapitres se trouvent ici.
